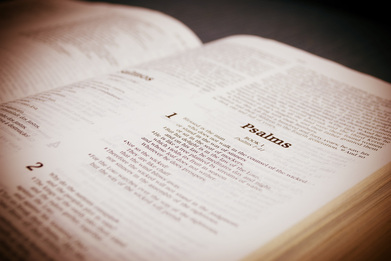
Etude des Psaumes
Introduction:
Le mot « Psaumes » signifie « Louanges ». Ce livre est l’écrit le plus important de la poésie hébraïque. Ses 150 chants de louange sont l’expression et le fruit de la piété hébraïque. Ils sont placés dans le groupe des « hagiographes » « KETOUBIM ». La Bible hébraïque les appelle « Sepher tebellim » = « Livre des louanges ». Ici, on est au coeur de la communion avec Dieu, c’est presque toujours l’homme qui parle à Dieu, tandis que dans les autres livres de la Bible, c’est Dieu qui parle aux hommes. On trouve réalisée dans ces louanges, l’adoration en esprit et en vérité. Jésus en a fait sa nourriture et sa force suprême jusqu’à la croix. L’espérance messianique y est largement soulignée. Les Psaumes sont cités plus de 70 fois dans le nouveau-testament.
1° Clef du livre: Adoration, prière et louange.
2° Verset central: Psaume 34/2: « Je bénirai l’Eternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche ».
3° Chapitre central: Psaume 119 ce chapitre souligne l’importance de la Parole de Dieu.
4° Auteurs:
Les deux tiers des Psaumes environ donnent le nom de leur auteur. Nous avons ainsi David qui en écrit 73, Asaph 12, les fils de Koré 10, Salomon 2, Moïse 1, Ethan et Héman, dont la sagesse pouvait être comparée à celle de Salomon en écrivirent chacun 1.
Asaph, était le chef des chantres, un chef de chorale désigné par Dieu. Les fils de Koré, eux, semblaient représenter un certain groupe de chanteurs, parmi les Lévites, à l’époque de David. Il reste quelques Psaumes dont on ne connaît pas l’auteur, mais plusieurs sont naturellement attribués à David. Son ombre se retrouve partout, dans ces écrits-là. Il partage ouvertement sa vie avec nous. Ce qu’il dit nous donne à chacun la possibilité de savoir que Dieu se soucie de nous, même dans les moments de découragement.
5° Destinataire: Ils s’adressent à Israël. Ce livre est un recueil de cantiques juifs.
6° Date de la composition du livre:
Une période de 1000 ans s’écoule de Moïse à Malachie.
7° Plan du livre:
Les 150 Psaumes, dans leur collection traditionnelle, se trouvent divisés en cinq sections. Chacune commence par une phrase de louange. Il est divisé en recueils; chacun se termine par une doxologie ou parole de louange à la gloire de Dieu.
La structure du livre est fort belle et très artistique.
Les 5 catégories sont les suivantes:
1ère Catégorie:
Psaumes 1 à 41. Cette section est composée en presque totalité des Psaumes de David et on l’appelle souvent le « recueil de David ». C’est l’homme qui répand son coeur devant Dieu (Psaumes 11-17-23-33...).
2ème Catégorie:
Psaume 42 à 72. Il commence par un groupe des 7 Psaumes des « fils de Koré » suivi d’un Psaume d’Asaph, de 18 de David, 1 de Salomon et 4 anonymes. On appelle ce recueil « les livres des fils de Koré ». C’est l’homme qui implore la grâce de Dieu (Psaumes 51-56-57...).
3ème Catégorie:
Psaumes 73 à 89. Il contient essentiellement des Psaumes d’Asaph (11), puis 3 Psaumes des fils de Koré, 1 de David, 1 d’Hémam et 1 d’Ethan. On l’appelle « le livre des Psaumes d’Asaph ». C’est l’homme qui recherche Dieu (Psaume 75-79-85-88...).
4ème Catégorie:
Psaumes 90 à 106. Il s’ouvre avec un Psaume de Moïse suivi de 2 Psaumes de David et de 14 anonymes. On l’appelle « le livre des Psaumes anonymes » C’est l’homme qui acclame Dieu dans son sanctuaire
(Psaumes 96-103...).
5ème catégorie:
Psaumes 107 à 150. Il se compose de 28 Psaumes anonymes entremêlés de 15 Psaumes de David et 1 Psaume de Salomon C’est l’homme qui raconte les bontés de Dieu (Psaumes 107-118-124...).
Notons entre autres le groupe « Hallel » ou « louange », « Alléluia », des Psaumes 113 à 118, le grand Hallel Egyptien. On l’appelle le « livre des solennités ». Les Juifs chantaient ces Psaumes à la fête de Pâque. Au coeur de ce recueil, se trouve le Psaume 119 qui fait l’éloge de la loi. Ce chapitre est divisé en 22 sections correspondantes aux 22 lettres de l’alphabet hébreu. Dans le texte hébreu, les 8 versets de chaque section commencent par la même lettre et les strophes se suivent dans l’ordre alphabétique, chaque lettre en étant l’en-tête, exemple:
Les 8 premiers versets débutent tous par la lettre ALEPH, (première lettre de l’alphabet hébreu) chacun des 8 versets suivants par la lettre BETH,(deuxième lettre de l’alphabet), etc.. Puis viennent les 15 Psaumes des degrés (chant des pèlerins montant à Jérusalem pour les grandes fêtes). Ce groupe des degrés s’appelle aussi le petit Hallel ou Psaumes débordant d’adoration et d’actions de grâce, aussi « Psaumes d’ascension » Selon une interprétation, les 15 mentions « cantique des degrés » font penser aux 15 marches accédant au parvis d’Israël dans le temple, où ces Psaumes étaient chantés. Les Psaumes peuvent d’autre part être groupés selon leur thème ou le sujet qu’ils évoquent. Parmi eux, on remarque les sujets que voici: les prières du juste, des chants de repentance et de confession, des cantiques de louange, des chants célébrant l’histoire d’Israël, des chants parlant du Messie (Jésus), des chants de détresse et d’autres encore, chargés d’enseignement.
8° Sommaire du livre:
Les Psaumes sont l’expression directe des expériences de leurs auteurs. Ils révèlent leurs expériences personnelles vécues par chaque âme. Ils nous donnent une image merveilleuse de la vie intérieure du Fils de Dieu, de ses desseins, de ses mobiles, de ses désirs, de ses motifs et de ses affections.
9° Enseignement pratique:
Les Psaumes sont l’élan du coeur des croyants vers leur Dieu. Ils s’appliquent aux enfants de Dieu de tous les temps, ils sont l’expression de la louange et de l’adoration, de la joie, et de l’affliction, de l’allégresse et de l’espérance du chrétien à travers les âges. Ils ont été plus que tous les autres livres une source de consolation, d’encouragement, d’instruction et de joie pour le peuple de Dieu.
10° Type messianique:
Nous voyons ici le Seigneur dans sa vie intérieure. Il est l’homme heureux du Psaume 1er, le Fils de Dieu à qui l’Eternel veut donner les nations pour héritage dans le Psaume 2ème, il est le Fils de l’homme du Psaume 8ème. Le Psaume 16 nous le présente comme le ressuscité, le 22 comme le serviteur souffrant. Dans le Psaumes 24 et 45 nous le saluons comme le roi. Dans le Psaume 110, il apparaît comme le Souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek. Dans le Psaume 119, il est la Parole de Dieu.
Certains traits de la vie et l’oeuvre de Jésus nous sont révélées prophétiquement dans les Psaumes.
11° Application dispensationnelle:
L’application spirituelle des Psaumes est pour les enfants de Dieu de tous les âges, mais plusieurs ont un caractère prophétique et ont leur accomplissement actuel. Si le Psaume 23 parle au coeur de l’homme tout le temps entouré de l’ennemi, de dangers, le Psaume 97 évoque le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre.
L’Eternel veut que la terre soit dans l’allégresse. Le Psaume 22 a connu son accomplissement lors de la venue de Jésus comme serviteur souffrant, tandis que le Psaume 24 connaîtra le sien lors du retour du Seigneur. On dit que le livre 1 aurait été réuni par Salomon, le livre 2 et 3 par Ezéchias, le livre 4 et 5 soit Esdras et Néhémie.
Il est remarquable que parmi toutes les citations de l’Ancien-testament dans le Nouveau-testament qui ont une signification messianique, presque la moitié vient des Psaumes.
A) LE ROI c’est-à-dire « l’Oint de l’Eternel » - Psaumes 2; 20; 21; 24; 45; 72; 110. Ces Psaumes nous parlent des titres du roi: « l’Oint » (Psaume 2/2); « le Roi de Sion » (Psaume 2/6); « le Fils de Dieu »
Psaume 2/6,7); le Psaume 45 nous parle du « mariage du Roi », il est « l’époux » du cantique des cantiques. Le Psaume 72 célèbre le « couronnement du Roi », Christ est le vrai prince de la Paix.
B) LE MESSIE - Psaumes 2; 3; 16; 22; 31; 40; 41; 45; 68; 69; 85; 89; 110; 118. Ces Psaumes nous parlent du Messie dans ses souffrances, ses humiliations et sa mort.
C) LE SACRIFICATEUR - Psaume 40. Ce Psaume, nous voyons Christ comme sacrificateur.
D) LE BERGER - Psaumes 22; 23; 24. Le Psaume 22 Christ comme le bon Berger dans sa mort
(Jean 10/11) = Mon Sauveur, la Croix, le passé = LA GRACE. Le Psaume 23 Christ comme le Grand Berger dans sa résurrection (Hébreux 13/20)= Mon Berger, la houlette, le présent = Le Saint-Esprit, la direction divine. Le Psaume 24 Christ comme le Souverain Berger dans sa gloire (1 Pierre 5/4)= Mon Roi, la couronne, l’avenir = la gloire.
NOTES COMPLEMENTAIRES:
Titres du Psautier:
Ils expriment le caractère de chaque poème et nous révélant le sens et la portée des Psaumes dans la piété d’Israël.
- Premier titre: MIZMOR, en grec « Spalmos ». C’est une poésie accompagnée de musique instrumentale par opposition à la musique vocale. Il y a 57 Spalmos.
- Deuxième titre: SCHIR, en grec « Odé ». C’est une poésie chantée; ce cantique chanté est parfois accompagné de musique instrumentale, il y en a 30.
- Troisième titre: MASKIL. Ce sont des poésies d’instruction ou psaumes didactiques, il y en a 13, qui appartiennent au recueil des fils de Koré.
- Quatrième titre: MICTAM. Traduit généralement par « hymne ». Il y en a 6; le Psaume 16 et les Psaumes 56 à 60.
- Cinquième titre: CHIGGAION. Un seul Psaume porte ce nom, le sens de ce mot est incertain. C’est un terme musical annonçant un mouvement rapide, voire même violent. Ce mot exprime bien le caractère du Psaume 9 où les pensées se pressent, se succèdent avec des transitions brèves, brusques et inattendues.
- Sixième titre: TEPHILLAH, « Prière ». C’est le titre de 5 Psaumes (Psaumes 17...).
- Septième titre: LAMENATSCAH. C’est-à-dire au chef des chantres ou pour le surveillant des chantres. Cette fonction était une charge considérable puisque sous David, 4 000 Lévites étaient mis à part pour louer l’Eternel avec des instruments. (1 Chroniques 23/5, 25, 26).
Autres titres ou formes: tous précédés du mot « au chef des chantres ».
A) Ne détruits pas (Psaume 57).
B) Sur les lis (Psaumes 45; 60; 69; 80) en tout 4 Psaumes.
C) Des formules se rapportant à usage liturgique: pour le sabbat (Psaume 92), pour la dédicace du Temple (Psaume 30) et pour la commémoration (Psaumes 38 et 70).
Note dominante. Malgré la note de tristesse dont il est parfois emprunt ce livre de louanges a pour dominante l’adoration, et cette adoration n’est pas seulement réservée au Temple, mais elle est destinée à être exercés en tous lieux, sous les cieux étoilés, dans les déserts, les cavernes, sur les montagnes. Ce livre nous fait aussi connaître l’âme humaine dans ses aspirations vers Dieu, ses élans de foi, et d’adoration, comme aussi dans ses moments de tristesse, de crainte, de découragement. Quand ils commencent dans le découragement, ils finissent dans la confiance.
Nous pouvons aussi classer les Psaumes par thème:
* Les 7 Psaumes de la Pénitence (Psaumes 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143°.
* Les Psaumes des Mourants (Psaumes 6; 16; 18; 23; 25; 31; 39; 55; 86; 90).
* Le Psaume des 7 promesses (Psaume 37).
* Le Psaume des rachetés (Psaume 107).
Il est intéressant de noter aussi les Psaumes dits « des Huguenots »:
* Le Psaume des batailles (Psaume 68).
* Le Psaume de la Persécution (Psaume 78) chanté par 14 jeunes gens en place de grève au moment de l’exécution.
* Le Psaume des martyrs (Psaume 118).
* Le Psaume de l’Assemblée (Psaume 138).
En conclusion, il est évident de connaître que les 150 psaumes de la bible ont été écrits dans des circonstances particulières dont chaque auteur ou groupe d’auteurs exprimait leur traversée de manière distincte. Il est donc encourageant a tous de les utiliser, suivant une circonstance appropriée.
Le Nom, les Noms de Dieu dans la Bible. Les Attributs de Dieu
Dans la Bible le nom a une grande importance car il donne la signification de la personne, ses qualités et ses attributs, en un mot ses vertus. Cette réflexion n’est bien sûr pas exhaustive….
D’une façon générale Dieu traduit deux mots hébreux «El» qui désigne la divinité, Dieu dans toute sa puissance. Et «Elohim» qui est un pluriel, il ne désigne pas un ensemble de dieux, mais le Dieu unique en qui sont tous les attributs divins.
Nous allons y rajouter le nom personnel de Dieu «Jéhovah» ou «Yahwé» par respect pour ce nom que les Juifs ne prononçaient même pas tel il était saint, c’est la raison pour laquelle il semble que personne ne sait vraiment si nous devons dire Jéhovah ou Yahwé. Il a souvent été traduit dans nos Bibles, par «Eternel» ou «Seigneur» . En donnant son nom à son peuple, Dieu a voulu se révéler. En donnant ce nom de Jéhovah qui se rattache à l’hébreu « Être » cela démontre sa présence active auprès des hommes, Jéhovah c’est Dieu qui se révèle pour notre aide et notre salut.
Le Nom Eternel (Jéhovah) est utilisé environ 6 000 fois dans la Bible, c’est le «je suis» il est l’origine de la vie, c’est Dieu qui s’unit à l’homme pour donner la vie. Il se rapporte au Dieu du salut et l’alliance qui se révèle à l’homme pour le sauver.
Tandis que le mon Dieu «Elohim» met l’accent sur la puissance divine.
Qui est Dieu comme toi ? crie le prophète : certains attributs de Dieu exprimant bien sa réalité ont été utilisés comme Nom ou titre en voici quelques-uns :
Dieu Saint, «… Et le Dieu Saint est….» Ésaïe 5.16.
Dieu Jaloux, «… Car l’Eternel porte le nom de Jaloux…» Exode 34.14.
Dieu Vivant, «… Lui le Dieu vivant…» Jérémie 10.10.
Dieu Très Haut, (ou Dieu de Là haut) «… M’inclinerais-je devant de Dieu Très Haut…» Michée 6.6.
Quelques noms différents de Dieu, qui expriment ses qualités, (attributs) :
Jéhovah-Jiré, (L'Eternel voit, pourvoit) «… Abraham donna à cet endroit le noms Jéhovah-Jiré. C’est pourquoi il dit aujourd’hui : sur la montagne de l’Éternel il sera pourvu….» Genèse 22.14.
Jéhovah-Rophi, (L'Eternel qui guérit) «… car je suis l’Eternel qui te guérit…» Exode 15.26.
Jéhovah-Nissi, (L'Eternel ma bannière) «… et il l’appela du nom de l’Éternel mon étendard…» Exode 17.15.
Jéhovah-Shalom, (L'Eternel paix) «… et lui donna pour nom l’Eternel Paix…» Juges 6.24.
Jéhovah-Sébaoth, (L'Eternel des armées) «… pour se prosterner devant l’Éternel des armées…» 1 Samuel 1.3.
Jéhovah-Roï, (L'Eternel mon berger) «… L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien…» Psaume 23.1.
Jéhovah-Shamma, (L'Eternel présent) «… l’Éternel est ici…» Ézéchiel 48.35.
Etc…
Il est le Dieu de l’univers, car :
Il est le Dieu Créateur, Ésaïe, 40.28, «Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence.»
Il est le Juge, Genèse 18.25, «Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?»
Il est Roi, Jérémie 10.7, «Qui ne te craindrait, roi des nations ? Car c’est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n’est semblable à toi»
Dieu de toute chair, Jérémie 32.27, «Voici ! Je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair, Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?»
Il est le Dieu de tout homme…
Ésaïe l’appelle son «Bien-aimé» Ésaïe 5.1, «… le chant de mon bien-aimé sur sa vigne…»
David l’appelle «Dieu de mon salut» Psaume 18.47 «… que le Dieu de mon salut soit exalté…»
La réalité de sa présence et l’amour qui lui est porté dans la vie de chaque jour transparaissent dans les riches métaphores utilisées pour le désigner :
Le Rocher, «… Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites…» Deutéronome 32.4.
Le Roc, «…Éternel mon roc…» Psaume 18.4.
La Forteresse, «…Éternel, ma forteresse…» Psaume 18.4.
Le Berger, «… L’Éternel est mon berger…» Psaume 23.1.
La Force, «…L’Éternel est ma force…» Psaume 28.7.
Le Bouclier, «… L’Éternel est mon bouclier …» Psaume 28.7.
Le Soleil, «… Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier…» Psaume 84.12.
L’Ombre, «… L’Éternel est ton ombre à ta main droite…» Psaume 121.5.
Le Refuge, «… Je dis tu es mon refuge…» Psaume 142.6.
Le Sauveur, «… ton Sauveur, le Saint d’Israël…» Ésaïe 41.14.
Un Héros, «… L’Éternel sort en héros…» Ésaïe 42.13.
La Source, «… Ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive…» Jérémie 2.13.
La Rosée, «… Je serai comme la rosée pour Israël…» Osée 14.6.
La persévérance jusqu’à la fin.
« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mt 24 :13)
Cette parole de Jésus souligne l’importance de la persévérance dans la vie chrétienne. Elle n’est pas la seule. Malgré les obstacles, les difficultés, les tentations, nous sommes appelés à « courir avec persévérance » la course qui nous est ouverte (Hb 12 :1). Nos regards peuvent – et doivent – se porter sur Jésus : il est notre modèle, il a « achevé l’oeuvre que le Père lui a donnée de faire » (Jn 17 :4) ; il est aussi notre motivation : « Il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême » (Jn 13 :2). Il est aussi, notre soutien, « celui qui suscite la foi et la mène à son accomplissement » (Hb 12 :2).
« Vous avez besoin de persévérance », dira l’auteur de l’Epitre aux Hébreux. Cette parole s’applique à chacun d’entre nous. Que d’occasions de nous assoupir – de nous décourager – de nous arrêter – de vouloir peut-être abandonner la partie. La vie chrétienne demande de la volonté, de la détermination. Jésus lui-même l’a montré. Nous l’avons dit à propos des « disciplines » de vie. Cette volonté a un sens : elle est un langage consistant pour dire notre amour pour Dieu.
Mais comment envisager cette persévérance ?
- est-elle seulement une exigence : « Vous devez persévérer jusqu’à la fin si vous voulez être sauvé » ? Avec la possibilité que certains puissent être nés de nouveau, mais sans persévérer… et qu’ils « perdent leur salut ».
- ou est-elle aussi une promesse : il y a, certes, l’exigence de la persévérance, mais il y a aussi, et avant tout Dieu qui, lui aussi est le Dieu de la persévérance, et qui s’engage à nos côtés, et pour nous, pour nous permettre de « persévérer jusqu’à la fin ».
Entre ces deux positions se joue, entre autres, la question de l’assurance du salut. Peut-on être sûr d’être sauvé ? Peut-on s’en réjouir, dès maintenant ? Ou faut-il attendre le terme de notre course fidèle, pour pouvoir seulement se réjouir d’un salut acquis ?
Nous venons de vivre les événements autour de la mort de Jean-Paul II. Parmi les attitudes frappantes, il y a eu ces fidèles qui, pendant son agonie et après, priaient pour le salut de son âme. On prie pour le salut de celui qui est sensé représenter le Christ sur terre ! Heureusement, on a aussi entendu des paroles d’assurance et de confiance en Dieu. Mais cela pose la question du fondement de l’assurance du salut : sur quoi repose-t-elle ? sur notre qualité de vie chrétienne ? ou sur l’engagement de Dieu envers nous ?
Comment donc envisager cette question de la persévérance ?
1. Les positions en présence
Pour situer le débat, on peut distinguer trois conceptions qui se sont développées dans l’histoire de la théologie à ce sujet.
1. La persévérance est la « part de l’homme » qu’il nous faut ajouter à la grâce pour aboutir à la vie éternelle. Elle dépend de l’homme. Il n’est pas certain que tous ceux qui ont accepté la grâce en Jésus-Christ et goûté la vie nouvelle soient sauvés. Certains peuvent perdre leur salut.
2. La persévérance est un « don de Dieu » fait à certains chrétiens, mais pas à tous : ce don est fait à tous les « élus », tous ceux que Dieu a choisis pour être éternellement avec lui. Mais : ces élus ne sont pas forcément tous ceux que Dieu a régénérés. Certains, parmi ceux qui ont la foi, et qui ont reçu la vie nouvelle en Jésus n’y persévèrent pas, et donc seront perdus.
3. La persévérance est un don de Dieu, qu’il accorde à tous ceux qu’il a régénérés, à chacun de ses enfants. Aucun de ceux-là ne sera perdu. Même si des chutes graves peuvent être envisagées.
La première thèse est défendue par de nombreux chrétiens évangéliques, en particulier ceux qui insistent sur part de l’homme et sur la liberté humaine dans le salut. On les « classe » parmi les « Arminiens », du nom d’un théologien hollandais, Jacques Arminius (1560–1609) qui s’était opposé aux « calvinistes » pour qui prime la souveraineté de Dieu par rapport à la liberté humaine. Beaucoup d’évangéliques soutiennent cette position, à cause du sens profond de la liberté, et de la responsabiité humaine. Ils la soutiennent aussi pour éviter de faire de l’assurance du salut un oreiller de paresse : savoir que l’on peut, peut-être perdre son salut, voilà qui incite à la vigilance !
La deuxième thèse est principalement défendue par la théologie catholique. C’était celle de St Augustin. Parmi les hommes pieux, certains reçoivent la grâce de la persévérance, d’autres pas : s’il en est ainsi, selon le plan de Dieu, c’est pour éviter les fausses sécurités. Le catholicisme d’après la Réforme précisera qu’en cas de péché mortel, le salut peut être perdu.
Définition : « Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en pleine conscience et de propos délibéré ». Il « entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c’est-à-dire de l’état de grâce. » Il peut être pardonné s’il est confessé. Mais il possède le pouvoir de causer la mort éternelle et l’enfer. Bien des nuances sont ensuite apportées par la théologie catholique : le concile de Trente envisage que ce péché est peut exister chez quelqu’un en qui subsiste la foi ; le Catéchisme de l’Eglise catholique rappelle la nécessité de « confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu ». [1]
La troisième position est défendue par les chrétiens qui insistent plus sur la « souveraineté de Dieu » dans le salut (« calvinistes »). Elle ne minimise pas la nécessité de la persévérance. Ni la gravité de certaines chutes. Mais elle affirme que le salut est aussi une question d’engagement de Dieu en faveur des siens, et tient à donner une pleine valeur à cet engagement.
Comment éclairer ce débat, comment décider ? La base, ce sont les textes bibliques. Nous voulons prendre le temps de parcourir les données bibliques, de les exposer. En indiquant ensuite à quels endroits se font les choix décisifs.
2. Les appels à la persévérance
Premier point à souligner : la Bible contient de multiples appels à la persévérance. Des appels très forts et très clairs.
21. Les appels positifs à la persévérance
« Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n’ait un coeur mauvais qui manque de foi et s’éloigne du Dieu vivant. 3:13 Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire « Aujourd’hui », pour qu’aucun de vous ne s’obstine à cause de l’attrait trompeur du péché. 3:14 Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés, jusqu’à la fin, à la réalité du commencement »
4:1 Craignons donc, tant que subsiste la promesse d’entrer dans son repos, que l’un de vous ne semble l’avoir manquée.
10:38–39 : « Or mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l’âme. »
22. Les avertissements et les menaces
Il y a les encouragements positifs à la persévérance. Mais aussi un certain nombre de menaces et d’avertissements, en cas de désobéissance ou d’abandon.
Ez 33 :18 : « Si le juste se détourne de sa justice et commet l’injustice, il mourra ».
Les exigences éthiques sont soulignées comme condition pour hériter du royaume de Dieu :
Ga 5 :19–21 : « Les oeuvres de la chair sont manifestes : inconduite sexuelle, impureté, débauche,idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions jalouses, fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. »
Promesses assorties d’exigences :
Col 1:22–23 : « Il vous a maintenant réconciliés, par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche – si vraiment vous demeurez, dans la foi, fondés et fermement établis, sans vous laisser emporter loin de l’espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. »
Menaces très fortes :
- contre l’orgueil et l’incrédulité, Rm 11 :20–22 : « Elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c’est par la foi que tu tiens. N’en tire pas orgueil, aie plutôt de la crainte; car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne t’épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté; autrement, toi aussi tu seras retranché. »
- conditions pour avoir part au règne avec le christ, 2 Tm 2 :11–12 : « 2:11 Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles (manquons de foi, NBS), lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » [2]
23. Comment recevoir ces paroles ?
1 Il y a, dans tous ces textes, un appel vigoureux à la persévérance, à la fidélité, à la vigilance, assorti d’un certain nombre de menaces. C’est d’abord cela qu’il nous faut enregistrer et recevoir. Il nous faut, il nous faudra, faire des choix clairs, coûteux parfois, de persévérance. Pas question de vivre notre vie chrétienne dans une tranquille assurance en chaise longue, lorsque l’exigence de fidélité se présente. Pas question, non plus, de nous dire que, comme de toute façon nous sommes pardonnés, nous pouvons vivre n’importe comment et pratiquer sans autre les œuvres contraires à la volonté de Dieu.
Les menaces sont réelles, et on comprend pourquoi. La repentance, c’est un changement d’attitude, une réorientation de notre volonté. Dire « Je suis pardonné, je peux faire le mal en toute impunité » c’est montrer qu’on ne s’est pas vraiment détourné de son péché. De plus, utiliser la croix de Christ pour se permettre de faire le mal, c’est se moquer du Christ, de ses souffrances, c’est lui cracher au visage.
2 Ces textes soulignent avec force la responsabilité humaine dans la vie chrétienne : nous avons à faire des choix, à respecter la Parole que Dieu nous adresse, à recevoir ses avertissements.
3 Ces textes favorisent-ils une position plutôt qu’une autre ? Tout dépend de la manière dont on conçoit le rapport entre l’action de l’homme et celle de Dieu dans notre vie.
- si on les voit comme deux réalités distinctes, côte à côte : « la part de Dieu », « la part de l’homme ». Alors on dira : Dieu donne le saut en JC, mais il y a une « part de l’homme », ensuite, pour la persévérance. Cette part est vraiment notre affaire. Si nous ne persévérons pas, nous tombons sous la menace, et pouvons perdre notre salut. Lus ainsi, ces textes semblent très fortement favoriser les deux premières positions.
- mais il y a une autre façon de voir les choses : il y a une « part de l’homme », certes, mais elle se trouve à l’intérieur de l’action et de la promesse de Dieu (non plus côte à côte, mais une réalité dans une autre). Dans cette seconde optique, la responsabilité humaine existe, mais elle est comme entourée, englobée dans quelque chose de plus large, qui est la promesse de la fidélité et de la persévérance de Dieu envers nous. Que se passe-t-il dans ce contexte ? Supposons que je sois tenté d’abandonner la foi… Dieu va, selon sa fidélité, me travailler, en sachant ma fragilité… Il va se servir de ses menaces : « Si mon juste se retire, je ne prends pas plaisir en lui… » Il va me travailler avec cela. En utilisant cette menace, il va réorienter mon vouloir et mon faire, par son Esprit, de telle sorte que je reprenne le bon chemin, ou la bonne attitude. La menace joue son rôle, car c’est une parole sérieuse. Mais elle s’inscrit à l’intérieur de la promesse, qui est plus large. Et c’est par ce moyen-là que Dieu réalise sa promesse.
Tout est une question de positionnement initial :
- si je vois ma volonté comme indépendante, comme « ma part », à côté de la « part de Dieu », les menaces de la Bible impliquent alors la possibilité que je perde mon salut. Il suffit d’être un peu lucides sur nous-mêmes, sur les faiblesses de notre volonté.
- si je vois ma volonté comme située à l’intérieur des promesses et de la fidélité de Dieu, là j’entre dans une autre dynamique. Une dynamique où Dieu se servira de toutes sortes de moyens, y compris ses menaces, pour me conduire ou me ramener à la persévérance qu’il désire pour moi. Pas d’automatismes, mais du « corps à corps » entre Dieu et moi… ce Dieu qui me suit, m’accompagne, veille sur moi, me redresse, me façonne… Dans cette optique, les menaces sont réelles, mais elles sont des moyens par lesquels Dieu va m’inciter à la persévérance. Car il poursuit son projet.
Que l’on considère ce qui se passe lorsque l’on donne un avertissement : « Attention, tu vas te brûler si tu t’approches de la flamme… » Il y a une vraie menace, un vrai danger. Imaginons un père donner cet avertissement, alors qu’il veille sur son enfant. Il ne veut pas que son enfant se brûle. Il sait qu’il interviendra en cas de danger. Mais il donne quand même l’avertissement : celui-ci joue son rôle préventif, même si le père sait qu’il interviendra en cas de transgression.
Une première bifurcation concerne donc la façon de concevoir le rapport entre ma volonté et l’action de Dieu.
Q. Peut-on décider dans un sens ou un autre ? La seconde vision des choses me paraît plus juste, pour rendre compte de l’ensemble de l’Ecriture. cf Ph 2 :13 : « Mettez en oeuvre votre salut, avec crainte et tremblement. Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » (1) vision « moitié-moitié » : Dieu fait le premier pas, allume la première étincelle… à vous de faire la suite, d’entretenir la flamme… mais ce n’est pas ce que dit le texte ! (2) vision souveraine unilatérale : Dieu fait tout dans sa souveraineté… tellement d’insistance que pas d’initiative du sujet. (3) vision d’accompagnement : une interaction constante… (i) Dieu qui agit dans les profondeurs de ma vie (fardeau, ressources pour l’obéissance, vie nouvelle) ; (ii) parce que Dieu agit, j’agis aussi : son action première libère mon initiative ; (iii) mais il y a aussi cette Parole, ce commandement : lorsqu’il m’interpelle, c’est à moi qu’il revient d’agir, de « mettre en œuvre » ; (iv) mais quand je le ferai, je devrais bien me dire, que, si j’agis, c’est parce que Saint-Esprit aura été là, pour me l’appliquer, et pour accompagner ma volonté.
3. Les promesses de l’engagement de Dieu
C’est ici qu’il faut considérer une deuxième série de textes : les promesses de Dieu, qui font de son action, de son engagement, le fondement de notre persévérance.
Elles sont de plusieurs ordres.
31. L’action de Dieu
Certaines parlent de l’action de Dieu : c’est lui qui nous garde, qui veille sur nous ; c’est lui qui nous relève, et affermit son oeuvre en nous.
1 pi 1:5 : « Vous êtes, par la puissance de Dieu (en dunamei theou), gardés par la foi (dia pisteôs) pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps »
jude 1 : Magnifique description des chrétiens : « appelés… aimés en Dieu… gardés pour JC ». Et l’application est précisée à la fin de la lettre : Jude 24 : « peut vous préserver de toute chute »
Ceci dit, les chutes existent. Mais le Seigneur promet d’être pour nous le Dieu qui nous relève : Ps 55 :23 -> « Il ne laissera pas chanceler le juste à jamais » (Semeur) Autre traduction : « Il ne laissera jamais chanceler le juste » (Segond, NBS) : si cela doit avoir un sens c’est à propos d’une chute définitive. Cf Ps 37 :24 : « S’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Eternel lui prend la main ».
Autre forme de l’action de Dieu : sa persévérance à poursuivre son oeuvre en nous.
D’autres textes insistent sur les « limites » auxquelles le Seigneur veille :
D’autres parlent de l’engagement de cœur du Seigneur envers chacun des siens :
Cet engagement se dit dans l’humilité et la reconnaissance : cf Canons de Dordrecht, V, III : « A cause de ces restes de péché qui habitent en nous, et des tentations du monde et de Satan, ceux qui sont convertis ne pourraient persister en cette grâce s’ils étaient laissés à leurs propres forces. Mais Dieu est fidèle : il les confirme miséricordieusement dans la grâce qu’il leur a une fois conférée, et les conserve puissamment jusqu’à la fin. »
Q. Comment ces textes sont-ils lus par ceux qui pensent que l’on peut « perdre son salut », et ne pas persévérer ?
La seule manière de les lire est de sous-entendre : « si l’homme demeure dans la foi ».
Difficulté : ce n’est pas ce que disent ces textes ! Ils ne disent pas « Dieu vous préserve si… » Ils disent « Dieu vous préserve de ne pas demeurer dans la foi ». Et il y a des absolus : « Rien », « aucune créature »… au nom de quoi nous exclure nous-mêmes ? un chrétien qui s’éloigne, renie… n’est-ce pas Satan qui l’aura détourné ? Or, il fait partie de ces « dominations, puissances, créatures » dont parle Rm 8.
Il n’y a pas de symétrie entre la façon dont les « calvinistes » intègrent les menaces, et celle dont les « arminiens » évacuent les promesses. Dans le cas des calvinistes : on peut faire une lecture non contradictoire, en faisant des menaces un moyen de la persévérance. Dans le cas des arminiens, on introduit une contradiction : ou bien personne ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, y compris nous-mêmes, ou le diable jouant sur notre faiblesse, ou bien cette parole est fausse. Cf Jn 6 :39 : ou bien la volonté du Père est accomplie, ou bien elle ne l’est pas.
4. Considérations théologiques
Deux autres considérations sont à verser au débat.
1. Le salut est par la foi seule, et non par les œuvres. Ep 2 :8–9. Il est question du « salut ». Et Paul précise : « Ce n’est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie ».
Si l’on fait de la « persévérance » la condition humaine du salut… ne devient-elle pas une « œuvre » ? Puisqu’on dit, précisément, que c’est l’homme, sa liberté qui est en cause ?
Dans le cas où la persévérance est une grâce, un don de Dieu, c’est différent !
2. Nulle part, le Nouveau Testament ne dissocie la régénération et le salut.
Je souligne cela en face de la 2e position : « Dieu régénère, mais tous les régénérés ne seront pas sauvés, ne recevront pas la grâce de la persévérance. Seuls les élus parmi les régénérés recevront le salut éternel, après avoir reçu la persévérance. »
Textes bibliques :
1 Pi 1 :3–6 : régénérés pour une espérance vivante… pour un héritage… à vous qui êtes gardés… pour le salut. Aucune distinction. Si on veut la voir, il faut la mettre ! Mais c’est surimposer qqch au texte.
Tit 3 :5 : Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération.
5. Les cas de chute ou d’abandon de la foi
Les deux séries de textes que nous avons considérés sont bien claires, l’une et l’autre. Il reste que certains textes semblent enseigner la possibilité pour quelqu’un de se détourner définitivement de la foi. Certains personnages bibliques, aussi, ont eu des chutes retentissantes. Et nous connaissons, chacun, des personnes qui apparemment ont commencé dans la foi, et qui ont tout laissé…
Il y a là une vraie difficulté. Qui exige de nous beaucoup d’attention aux textes, ainsi qu’à l’unité de l’Écriture.
51. Les faux-docteurs qui se lèvent dans l’Eglise.
2 Pi 2 :1–2 ; 2 :20–22 : Voilà des gens qui se sont introduits dans l’Église, après avoir eu une « connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 :20). Mais qui se détournent ensuite, s’abandonnent à leurs passions, et cherchent à détourner les autres chrétiens. L’apôtre a des mots très durs contre eux. Si on lit tout le chapitre, on a un réquisitoire parmi les plus forts contre des personnes, dans tout le NT (cf 2 :10b-12).
Q. Qui sont ces personnes, spirituellement ? 2 possibilités :
La possibilité d’une piété d’apparence
Le NT est très clair sur la possibilité d’une piété d’apparence, d’extériorité, qui fait illusion pendant un temps. Cf 1 Jn 2 :18–19. Il y a là une réalité qu’il nous faut intégrer dans notre vision des choses.
Jésus est allé très loin dans sa mise en garde : Mt 7 :22–23 (contexte = faux prophètes, 7 :15). Verdict de Jésus : « Je ne vous ai jamais connus ». (7 :23). Pas : « vous êtes tombés, vous avez abandonné… » Piété d’apparence. Toutes sortes de paroles, d’actes de puissance même ! Difficile à entendre, mais présent dans NT ! Critère = fruits (7 :16).
Avant ces extrêmes, rappeler la parabole du semeur : il peut y avoir plusieurs types de « réception de la Parole ». Jésus a soin, ici, de ne pas parler simplement en « noir ou blanc » : ceux qui acceptent / ceux qui refusent. Il y a deux catégories intermédiaires : « ceux qui acceptent avec joie, mais sans racine » ; « ceux qui acceptent, mais laissent ensuite être étouffée la Parole ». Ce sont à chaque fois les réponses d’un moment, d’une émotion, d’une sincérité. mais pas réfénération, bonne terre.
52. Les mises en garde contre l’abandon de la foi
L’Epître aux Hébreux va très loin dans ses menaces.
Hb 6 :4–8 (+ 6 :9–10) : voilà des personnes en qui une œuvre de Dieu s’est faite (6 :4 : « éclairés », « goûté le don céleste », « eu part au SE », « goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir ». Et pourtant, menace réelle : si elles tombent, elles ne pourront pas être renouvelées « à nouveau », et amenées à la repentance.
Quelles sont les lectures de ce passage ?
(1) Il s’agit là de gens authentiquement nés de nouveau, et qui peuvent donc tomber définitivement. On souligne la force des mots qui décrivent leur expérience spirituelle. On en déduit qu’il y a là une vraie possibilité pour le chrétien.
(2) On est encore dans l’avertissement. Le plus solennel qu’il soit. Parce que la situation des lecteurs est grave, la tentation d’abandonner très forte. L’auteur multiplie les termes pour que ses destinataires se reconnaissent bien : attention, pas de renouvellement possible si vous niez Jésus comme le Christ, en retournant au Judaïsme. Parole forte, car situation grave. Mais son attente, sa confiance regardent plus loin : 6 :9 -> « Quoi qu’il en soit, nous attendons des choses meilleures en ce qui vous concerne, et favorables au salut ». Il a confiance, il attend de Dieu, que son exhortation serve à les maintenir dans la persévérance. [3]
Le contexte, en tout cas, éclaire une expression : « Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu ». A comprendre dans le contexte de tentation de retour au Judaïsme : ce retour implique la négation que Jésus est l’Envoyé de Dieu, et donc le sens de son sacrifice. Cf toute l’argumentation de l’épître, pour montrer le caractère unique de Jésus : c’est tout cela qui serait nié par un retour en arrière.
(3) Une troisième interprétation trouve la précédente quelque peu artificielle et préfère voir l’ensemble de ce passage comme une explication de la raison pour laquelle l’auteur ne va pas revenir aux « choses élémentaires » (6 :1) : cette prédication-là ne pourrait pas convaincre ceux qui sont déjà tombés. Qui sont déjà retournés au judaïsme. Il y a donc un jugement de fait, à propos de personnes déjà tombées. Question : ces personnes étaient-elles vraiment régénérées ? On relève alors que l’auteur évite soigneusement de parler de « régénération ». Qu’il parle même d’eux comme une terre qui, bien qu’arrosée, produit des épines et des chardons (6 :8). Quelque chose a levé, s’est passé, mais ce n’est pas la bonne terre : la nature n’a pas été régénérée, malgré les privilèges extérieurs (pluie). Cf H.Blocher, R.Nicole.
La différence entre (ii) et (iii) est surtout une question de sensibilité « littéraire » : est-ce que l’auteur est encore dans un processus où il essaie d’avertir, ou est-ce qu’il constate que, pour certains, le mal est fait, sans pour autant dire qu’ils étaient régénérés ? Personnellement, je préfère la solution (ii) : parce que toute l’épître est un avertissement, et l’auteur est pleinement engagé, tout au long, dans son plaidoyer pour que ses destinataires, ébranlés, tiennent bon dans leur foi en Christ.
Ceci dit, il faut rendre compte du langage sur l’oeuvre de Dieu réalisée dans les personnes que l’auteur avertit. Ce langage signifie-t-il qu’ils sont nés de nouveau ?
Il faut, ici, se rendre compte de la difficulté que rencontre l’auteur s’il veut avertir avec force ses destinataires chancelants. Il a toutes les raisons de croire qu’ils sont authentiquement au Seigneur (6 :9). En même temps, si certains retournent au Judaïsme et nient Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils montreront par là qu’en effet, ils étaient une « mauvaise terre », pas vraiment renouvelée par le Seigneur, malgré ce qui s’était passé en eux, et qui avait commencé à lever (6 :8). Que fait-on, quand on est prédicateur, et qu’on est en face de ce genre de situation ? On choisit ses mots, avec soin, on va aussi loin que l’on peut sans aller trop loin. C’est ce qu’on voit ici : les mots qu’il emploie sont susceptibles d’une interprétation « faible » comme d’une interpétation « forte ».
Être « éclairé » : sens fort : avoir reçu la lumière, pour une illumination qui transforme, ou (sens faible) comme « connaissance » qui n’a pas fait tout son chemin de renouvellement…
« avoir goûté le don céleste » : peut signifier (sens fort) : « goûter que le Seigneur est bon » ; ou «(sens faible) avoir eu une toute petite quantité, pour essayer (Cana).
« avoir pris part au SE » : peut signifier (sens fort) une pleine participation, ou (sens faible) une participation à un moindre niveau (première sensibilisation, participation extérieure).
Ce qu’il faut reconnaître, c’est que qqch s’est fait : il est impossible qu’ils soient « encore » renouvelés. Une première action de Dieu dans le coeur est présupposée. Mais à quel niveau ? On peut lire le « plus » ou le « moins ».
Ma lecture : l’auteur va aussi loin qu’il peut parce qu’il veut avertir ses destinataires chrétiens en attendant des choses « favorables au salut » ; mais il garde une réserve dans les termes (pas « régénéré »), au cas où, parmi ses destinataires, certains « tombent » (v.6) et manifestent par là qu’il « n’étaient pas » une bonne terre. Quand on est prédicateur, et qu’on s’adresse à un auditoire varié, on pèse parfois les mots de cette façon.
Une lecture qui, dans le contexte, se comprend bien, sans remettre en question les promesses de persévérance finale pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau.
Même lecture pour le texte d’Hb 10 :26–29. Contexte = négation de Jésus comme Christ et sauveur qu’implique le retour au judaïsme. Avec un point à élucider : « sang de l’alliance par lequel il a été sanctifié ». Qui ? Le croyant ? Probablement, Jésus est ici désigné : cf Jn 17 :19, qui correspond à la christologie de toute l’épître (2 :10 – Christ « rendu parfait » en tant que grand Prêtre, par le don de lui-même).
53. Les exemples personnels de défection
Il y a des exemples de chute, ou de défection. Reniement de Pierre, adultère criminel de David. Gens qui « n’étaient pas des nôtres ».
Nous n’en savons pas beaucoup sur les cas. Attention aux conclusions hâtives. Quelques repères quand même.
1. Chute grave, mais avec retour : cf Pierre – David
2. Abandons grave, qui ne signifient pas forcément « perdre la grâce » : Démas (2 Tm 4 :10, cf 1 :15). Paul se garde d’un jugement, qu’il donne pourtant plus loin : 4 :14–15 (Alexandre le forgeron).
3. « Renier la foi » peut signifier un « comportement contraire à la foi » : 1 Tm 5 :8. H.Blocher : « Celui qui fait cela est plus blâmable qu’un infidèle, mais il ne cesse d’être croyant « Égaré loin de la foi » (1 Tm 6 :10, par l’argent ; 6 :21, par les fables, disputes) : échec pratique ? vie chrétienne manquée ? salut, mais au travers du feu ? Cf « naufrage par rapport à la foi », 1 Tm 1 :19
4. 1 Tm 1 :20 : Hyménée et Alexandre, « livrés à Satan afin qu’ils apprennent à ne plus blasphémer ». Cela signifie-t-il « voués à l’enfer » ? Il faut relever une expression semblable avec une portée moindre, en 1 Co 5 :5 -> jugement temporel.
5. 1 Jn 2 :19 : le cas des antichrists – clairement « ils n’étaient pas des nôtres ».
Il est utile qu’il y ait toute cette palette de cas dans le NT. Cela donne une latitude de possibilités pour les cas difficiles. C’est vrai, il ne faut pas nier qu’il y a des cas troublants. Mais il me semble que les catégories du NT sont assez large pour en intégrer plusieurs, sans pour autant parler de « perte du salut ».
Octobre2013
HPC10062013
Dans la Bible le nom a une grande importance car il donne la signification de la personne, ses qualités et ses attributs, en un mot ses vertus. Cette réflexion n’est bien sûr pas exhaustive….
D’une façon générale Dieu traduit deux mots hébreux «El» qui désigne la divinité, Dieu dans toute sa puissance. Et «Elohim» qui est un pluriel, il ne désigne pas un ensemble de dieux, mais le Dieu unique en qui sont tous les attributs divins.
Nous allons y rajouter le nom personnel de Dieu «Jéhovah» ou «Yahwé» par respect pour ce nom que les Juifs ne prononçaient même pas tel il était saint, c’est la raison pour laquelle il semble que personne ne sait vraiment si nous devons dire Jéhovah ou Yahwé. Il a souvent été traduit dans nos Bibles, par «Eternel» ou «Seigneur» . En donnant son nom à son peuple, Dieu a voulu se révéler. En donnant ce nom de Jéhovah qui se rattache à l’hébreu « Être » cela démontre sa présence active auprès des hommes, Jéhovah c’est Dieu qui se révèle pour notre aide et notre salut.
Le Nom Eternel (Jéhovah) est utilisé environ 6 000 fois dans la Bible, c’est le «je suis» il est l’origine de la vie, c’est Dieu qui s’unit à l’homme pour donner la vie. Il se rapporte au Dieu du salut et l’alliance qui se révèle à l’homme pour le sauver.
Tandis que le mon Dieu «Elohim» met l’accent sur la puissance divine.
Qui est Dieu comme toi ? crie le prophète : certains attributs de Dieu exprimant bien sa réalité ont été utilisés comme Nom ou titre en voici quelques-uns :
Dieu Saint, «… Et le Dieu Saint est….» Ésaïe 5.16.
Dieu Jaloux, «… Car l’Eternel porte le nom de Jaloux…» Exode 34.14.
Dieu Vivant, «… Lui le Dieu vivant…» Jérémie 10.10.
Dieu Très Haut, (ou Dieu de Là haut) «… M’inclinerais-je devant de Dieu Très Haut…» Michée 6.6.
Quelques noms différents de Dieu, qui expriment ses qualités, (attributs) :
Jéhovah-Jiré, (L'Eternel voit, pourvoit) «… Abraham donna à cet endroit le noms Jéhovah-Jiré. C’est pourquoi il dit aujourd’hui : sur la montagne de l’Éternel il sera pourvu….» Genèse 22.14.
Jéhovah-Rophi, (L'Eternel qui guérit) «… car je suis l’Eternel qui te guérit…» Exode 15.26.
Jéhovah-Nissi, (L'Eternel ma bannière) «… et il l’appela du nom de l’Éternel mon étendard…» Exode 17.15.
Jéhovah-Shalom, (L'Eternel paix) «… et lui donna pour nom l’Eternel Paix…» Juges 6.24.
Jéhovah-Sébaoth, (L'Eternel des armées) «… pour se prosterner devant l’Éternel des armées…» 1 Samuel 1.3.
Jéhovah-Roï, (L'Eternel mon berger) «… L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien…» Psaume 23.1.
Jéhovah-Shamma, (L'Eternel présent) «… l’Éternel est ici…» Ézéchiel 48.35.
Etc…
Il est le Dieu de l’univers, car :
Il est le Dieu Créateur, Ésaïe, 40.28, «Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence.»
Il est le Juge, Genèse 18.25, «Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?»
Il est Roi, Jérémie 10.7, «Qui ne te craindrait, roi des nations ? Car c’est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n’est semblable à toi»
Dieu de toute chair, Jérémie 32.27, «Voici ! Je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair, Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?»
Il est le Dieu de tout homme…
Ésaïe l’appelle son «Bien-aimé» Ésaïe 5.1, «… le chant de mon bien-aimé sur sa vigne…»
David l’appelle «Dieu de mon salut» Psaume 18.47 «… que le Dieu de mon salut soit exalté…»
La réalité de sa présence et l’amour qui lui est porté dans la vie de chaque jour transparaissent dans les riches métaphores utilisées pour le désigner :
Le Rocher, «… Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites…» Deutéronome 32.4.
Le Roc, «…Éternel mon roc…» Psaume 18.4.
La Forteresse, «…Éternel, ma forteresse…» Psaume 18.4.
Le Berger, «… L’Éternel est mon berger…» Psaume 23.1.
La Force, «…L’Éternel est ma force…» Psaume 28.7.
Le Bouclier, «… L’Éternel est mon bouclier …» Psaume 28.7.
Le Soleil, «… Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier…» Psaume 84.12.
L’Ombre, «… L’Éternel est ton ombre à ta main droite…» Psaume 121.5.
Le Refuge, «… Je dis tu es mon refuge…» Psaume 142.6.
Le Sauveur, «… ton Sauveur, le Saint d’Israël…» Ésaïe 41.14.
Un Héros, «… L’Éternel sort en héros…» Ésaïe 42.13.
La Source, «… Ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive…» Jérémie 2.13.
La Rosée, «… Je serai comme la rosée pour Israël…» Osée 14.6.
La persévérance jusqu’à la fin.
« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mt 24 :13)
Cette parole de Jésus souligne l’importance de la persévérance dans la vie chrétienne. Elle n’est pas la seule. Malgré les obstacles, les difficultés, les tentations, nous sommes appelés à « courir avec persévérance » la course qui nous est ouverte (Hb 12 :1). Nos regards peuvent – et doivent – se porter sur Jésus : il est notre modèle, il a « achevé l’oeuvre que le Père lui a donnée de faire » (Jn 17 :4) ; il est aussi notre motivation : « Il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême » (Jn 13 :2). Il est aussi, notre soutien, « celui qui suscite la foi et la mène à son accomplissement » (Hb 12 :2).
« Vous avez besoin de persévérance », dira l’auteur de l’Epitre aux Hébreux. Cette parole s’applique à chacun d’entre nous. Que d’occasions de nous assoupir – de nous décourager – de nous arrêter – de vouloir peut-être abandonner la partie. La vie chrétienne demande de la volonté, de la détermination. Jésus lui-même l’a montré. Nous l’avons dit à propos des « disciplines » de vie. Cette volonté a un sens : elle est un langage consistant pour dire notre amour pour Dieu.
Mais comment envisager cette persévérance ?
- est-elle seulement une exigence : « Vous devez persévérer jusqu’à la fin si vous voulez être sauvé » ? Avec la possibilité que certains puissent être nés de nouveau, mais sans persévérer… et qu’ils « perdent leur salut ».
- ou est-elle aussi une promesse : il y a, certes, l’exigence de la persévérance, mais il y a aussi, et avant tout Dieu qui, lui aussi est le Dieu de la persévérance, et qui s’engage à nos côtés, et pour nous, pour nous permettre de « persévérer jusqu’à la fin ».
Entre ces deux positions se joue, entre autres, la question de l’assurance du salut. Peut-on être sûr d’être sauvé ? Peut-on s’en réjouir, dès maintenant ? Ou faut-il attendre le terme de notre course fidèle, pour pouvoir seulement se réjouir d’un salut acquis ?
Nous venons de vivre les événements autour de la mort de Jean-Paul II. Parmi les attitudes frappantes, il y a eu ces fidèles qui, pendant son agonie et après, priaient pour le salut de son âme. On prie pour le salut de celui qui est sensé représenter le Christ sur terre ! Heureusement, on a aussi entendu des paroles d’assurance et de confiance en Dieu. Mais cela pose la question du fondement de l’assurance du salut : sur quoi repose-t-elle ? sur notre qualité de vie chrétienne ? ou sur l’engagement de Dieu envers nous ?
Comment donc envisager cette question de la persévérance ?
1. Les positions en présence
Pour situer le débat, on peut distinguer trois conceptions qui se sont développées dans l’histoire de la théologie à ce sujet.
1. La persévérance est la « part de l’homme » qu’il nous faut ajouter à la grâce pour aboutir à la vie éternelle. Elle dépend de l’homme. Il n’est pas certain que tous ceux qui ont accepté la grâce en Jésus-Christ et goûté la vie nouvelle soient sauvés. Certains peuvent perdre leur salut.
2. La persévérance est un « don de Dieu » fait à certains chrétiens, mais pas à tous : ce don est fait à tous les « élus », tous ceux que Dieu a choisis pour être éternellement avec lui. Mais : ces élus ne sont pas forcément tous ceux que Dieu a régénérés. Certains, parmi ceux qui ont la foi, et qui ont reçu la vie nouvelle en Jésus n’y persévèrent pas, et donc seront perdus.
3. La persévérance est un don de Dieu, qu’il accorde à tous ceux qu’il a régénérés, à chacun de ses enfants. Aucun de ceux-là ne sera perdu. Même si des chutes graves peuvent être envisagées.
La première thèse est défendue par de nombreux chrétiens évangéliques, en particulier ceux qui insistent sur part de l’homme et sur la liberté humaine dans le salut. On les « classe » parmi les « Arminiens », du nom d’un théologien hollandais, Jacques Arminius (1560–1609) qui s’était opposé aux « calvinistes » pour qui prime la souveraineté de Dieu par rapport à la liberté humaine. Beaucoup d’évangéliques soutiennent cette position, à cause du sens profond de la liberté, et de la responsabiité humaine. Ils la soutiennent aussi pour éviter de faire de l’assurance du salut un oreiller de paresse : savoir que l’on peut, peut-être perdre son salut, voilà qui incite à la vigilance !
La deuxième thèse est principalement défendue par la théologie catholique. C’était celle de St Augustin. Parmi les hommes pieux, certains reçoivent la grâce de la persévérance, d’autres pas : s’il en est ainsi, selon le plan de Dieu, c’est pour éviter les fausses sécurités. Le catholicisme d’après la Réforme précisera qu’en cas de péché mortel, le salut peut être perdu.
Définition : « Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en pleine conscience et de propos délibéré ». Il « entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c’est-à-dire de l’état de grâce. » Il peut être pardonné s’il est confessé. Mais il possède le pouvoir de causer la mort éternelle et l’enfer. Bien des nuances sont ensuite apportées par la théologie catholique : le concile de Trente envisage que ce péché est peut exister chez quelqu’un en qui subsiste la foi ; le Catéchisme de l’Eglise catholique rappelle la nécessité de « confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu ». [1]
La troisième position est défendue par les chrétiens qui insistent plus sur la « souveraineté de Dieu » dans le salut (« calvinistes »). Elle ne minimise pas la nécessité de la persévérance. Ni la gravité de certaines chutes. Mais elle affirme que le salut est aussi une question d’engagement de Dieu en faveur des siens, et tient à donner une pleine valeur à cet engagement.
Comment éclairer ce débat, comment décider ? La base, ce sont les textes bibliques. Nous voulons prendre le temps de parcourir les données bibliques, de les exposer. En indiquant ensuite à quels endroits se font les choix décisifs.
2. Les appels à la persévérance
Premier point à souligner : la Bible contient de multiples appels à la persévérance. Des appels très forts et très clairs.
21. Les appels positifs à la persévérance
- J’ai cité la parole de Jésus : « Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé ». Elle se trouve dans le discours « eschatologique » de Jésus (Mt 24 :13). Il faut en relever le contexte : il s’agit des temps de persécution et d’apostasie. Des prophètes de mensonge se lèvent (24 :11). Et même « l’amour de la multitude se refroidira » à cause du mal qui prolifère (24 :12). mais, celui qui, au milieu de tout cela, persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. On voit toute l’exigence de cette parole. Un appel fort à la fidélité, à la constance, à la résistance…
- L’épître aux Hébreux a plusieurs appels du même ordre : contexte est celui de chrétiens d’origine juive qui sont tentés, sous la pression, de renoncer à leur foi en Jésus. Vraie tentation. A plusieurs reprises dans sa lettre, l’auteur incite fortement à la persévérance, en souligne l’absolue nécessité.
« Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n’ait un coeur mauvais qui manque de foi et s’éloigne du Dieu vivant. 3:13 Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire « Aujourd’hui », pour qu’aucun de vous ne s’obstine à cause de l’attrait trompeur du péché. 3:14 Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés, jusqu’à la fin, à la réalité du commencement »
4:1 Craignons donc, tant que subsiste la promesse d’entrer dans son repos, que l’un de vous ne semble l’avoir manquée.
10:38–39 : « Or mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l’âme. »
22. Les avertissements et les menaces
Il y a les encouragements positifs à la persévérance. Mais aussi un certain nombre de menaces et d’avertissements, en cas de désobéissance ou d’abandon.
Ez 33 :18 : « Si le juste se détourne de sa justice et commet l’injustice, il mourra ».
Les exigences éthiques sont soulignées comme condition pour hériter du royaume de Dieu :
Ga 5 :19–21 : « Les oeuvres de la chair sont manifestes : inconduite sexuelle, impureté, débauche,idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions jalouses, fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. »
Promesses assorties d’exigences :
Col 1:22–23 : « Il vous a maintenant réconciliés, par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche – si vraiment vous demeurez, dans la foi, fondés et fermement établis, sans vous laisser emporter loin de l’espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. »
Menaces très fortes :
- contre l’orgueil et l’incrédulité, Rm 11 :20–22 : « Elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi, et toi, c’est par la foi que tu tiens. N’en tire pas orgueil, aie plutôt de la crainte; car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne t’épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté; autrement, toi aussi tu seras retranché. »
- conditions pour avoir part au règne avec le christ, 2 Tm 2 :11–12 : « 2:11 Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles (manquons de foi, NBS), lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » [2]
23. Comment recevoir ces paroles ?
1 Il y a, dans tous ces textes, un appel vigoureux à la persévérance, à la fidélité, à la vigilance, assorti d’un certain nombre de menaces. C’est d’abord cela qu’il nous faut enregistrer et recevoir. Il nous faut, il nous faudra, faire des choix clairs, coûteux parfois, de persévérance. Pas question de vivre notre vie chrétienne dans une tranquille assurance en chaise longue, lorsque l’exigence de fidélité se présente. Pas question, non plus, de nous dire que, comme de toute façon nous sommes pardonnés, nous pouvons vivre n’importe comment et pratiquer sans autre les œuvres contraires à la volonté de Dieu.
Les menaces sont réelles, et on comprend pourquoi. La repentance, c’est un changement d’attitude, une réorientation de notre volonté. Dire « Je suis pardonné, je peux faire le mal en toute impunité » c’est montrer qu’on ne s’est pas vraiment détourné de son péché. De plus, utiliser la croix de Christ pour se permettre de faire le mal, c’est se moquer du Christ, de ses souffrances, c’est lui cracher au visage.
2 Ces textes soulignent avec force la responsabilité humaine dans la vie chrétienne : nous avons à faire des choix, à respecter la Parole que Dieu nous adresse, à recevoir ses avertissements.
3 Ces textes favorisent-ils une position plutôt qu’une autre ? Tout dépend de la manière dont on conçoit le rapport entre l’action de l’homme et celle de Dieu dans notre vie.
- si on les voit comme deux réalités distinctes, côte à côte : « la part de Dieu », « la part de l’homme ». Alors on dira : Dieu donne le saut en JC, mais il y a une « part de l’homme », ensuite, pour la persévérance. Cette part est vraiment notre affaire. Si nous ne persévérons pas, nous tombons sous la menace, et pouvons perdre notre salut. Lus ainsi, ces textes semblent très fortement favoriser les deux premières positions.
- mais il y a une autre façon de voir les choses : il y a une « part de l’homme », certes, mais elle se trouve à l’intérieur de l’action et de la promesse de Dieu (non plus côte à côte, mais une réalité dans une autre). Dans cette seconde optique, la responsabilité humaine existe, mais elle est comme entourée, englobée dans quelque chose de plus large, qui est la promesse de la fidélité et de la persévérance de Dieu envers nous. Que se passe-t-il dans ce contexte ? Supposons que je sois tenté d’abandonner la foi… Dieu va, selon sa fidélité, me travailler, en sachant ma fragilité… Il va se servir de ses menaces : « Si mon juste se retire, je ne prends pas plaisir en lui… » Il va me travailler avec cela. En utilisant cette menace, il va réorienter mon vouloir et mon faire, par son Esprit, de telle sorte que je reprenne le bon chemin, ou la bonne attitude. La menace joue son rôle, car c’est une parole sérieuse. Mais elle s’inscrit à l’intérieur de la promesse, qui est plus large. Et c’est par ce moyen-là que Dieu réalise sa promesse.
Tout est une question de positionnement initial :
- si je vois ma volonté comme indépendante, comme « ma part », à côté de la « part de Dieu », les menaces de la Bible impliquent alors la possibilité que je perde mon salut. Il suffit d’être un peu lucides sur nous-mêmes, sur les faiblesses de notre volonté.
- si je vois ma volonté comme située à l’intérieur des promesses et de la fidélité de Dieu, là j’entre dans une autre dynamique. Une dynamique où Dieu se servira de toutes sortes de moyens, y compris ses menaces, pour me conduire ou me ramener à la persévérance qu’il désire pour moi. Pas d’automatismes, mais du « corps à corps » entre Dieu et moi… ce Dieu qui me suit, m’accompagne, veille sur moi, me redresse, me façonne… Dans cette optique, les menaces sont réelles, mais elles sont des moyens par lesquels Dieu va m’inciter à la persévérance. Car il poursuit son projet.
Que l’on considère ce qui se passe lorsque l’on donne un avertissement : « Attention, tu vas te brûler si tu t’approches de la flamme… » Il y a une vraie menace, un vrai danger. Imaginons un père donner cet avertissement, alors qu’il veille sur son enfant. Il ne veut pas que son enfant se brûle. Il sait qu’il interviendra en cas de danger. Mais il donne quand même l’avertissement : celui-ci joue son rôle préventif, même si le père sait qu’il interviendra en cas de transgression.
Une première bifurcation concerne donc la façon de concevoir le rapport entre ma volonté et l’action de Dieu.
Q. Peut-on décider dans un sens ou un autre ? La seconde vision des choses me paraît plus juste, pour rendre compte de l’ensemble de l’Ecriture. cf Ph 2 :13 : « Mettez en oeuvre votre salut, avec crainte et tremblement. Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » (1) vision « moitié-moitié » : Dieu fait le premier pas, allume la première étincelle… à vous de faire la suite, d’entretenir la flamme… mais ce n’est pas ce que dit le texte ! (2) vision souveraine unilatérale : Dieu fait tout dans sa souveraineté… tellement d’insistance que pas d’initiative du sujet. (3) vision d’accompagnement : une interaction constante… (i) Dieu qui agit dans les profondeurs de ma vie (fardeau, ressources pour l’obéissance, vie nouvelle) ; (ii) parce que Dieu agit, j’agis aussi : son action première libère mon initiative ; (iii) mais il y a aussi cette Parole, ce commandement : lorsqu’il m’interpelle, c’est à moi qu’il revient d’agir, de « mettre en œuvre » ; (iv) mais quand je le ferai, je devrais bien me dire, que, si j’agis, c’est parce que Saint-Esprit aura été là, pour me l’appliquer, et pour accompagner ma volonté.
3. Les promesses de l’engagement de Dieu
C’est ici qu’il faut considérer une deuxième série de textes : les promesses de Dieu, qui font de son action, de son engagement, le fondement de notre persévérance.
Elles sont de plusieurs ordres.
31. L’action de Dieu
Certaines parlent de l’action de Dieu : c’est lui qui nous garde, qui veille sur nous ; c’est lui qui nous relève, et affermit son oeuvre en nous.
1 pi 1:5 : « Vous êtes, par la puissance de Dieu (en dunamei theou), gardés par la foi (dia pisteôs) pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps »
jude 1 : Magnifique description des chrétiens : « appelés… aimés en Dieu… gardés pour JC ». Et l’application est précisée à la fin de la lettre : Jude 24 : « peut vous préserver de toute chute »
Ceci dit, les chutes existent. Mais le Seigneur promet d’être pour nous le Dieu qui nous relève : Ps 55 :23 -> « Il ne laissera pas chanceler le juste à jamais » (Semeur) Autre traduction : « Il ne laissera jamais chanceler le juste » (Segond, NBS) : si cela doit avoir un sens c’est à propos d’une chute définitive. Cf Ps 37 :24 : « S’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Eternel lui prend la main ».
Autre forme de l’action de Dieu : sa persévérance à poursuivre son oeuvre en nous.
- Phil 1 :6 : « Celui qui a commencé en vous… »
- 1 Co 1 :8–9 : « Il vous affermira.. Dieu est fidèle » A propos des Corinthiens, dont Paul n’ignorait rien ! Et c’est eux qu’il avertit contre la débauche, qui ne permet pas d’hériter du Royaume de Dieu, 6 :9–10.
- 1 Th 5 :23–24 : Que Dieu vous sanctifie… conserve irréprochable… Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.
D’autres textes insistent sur les « limites » auxquelles le Seigneur veille :
- 1 Co 10 :13 : limites de l’épreuve, de la tentation
- Mt 24 :22 : limites des temps difficiles, en vue du salut. (« à cause des élus »)
D’autres parlent de l’engagement de cœur du Seigneur envers chacun des siens :
- Jésus, le bon berger, s’engage à l’égard ceux qui font partie de son troupeau : il y a une relation personnelle entre elles et lui (Jn 10 :3 –> « par leur nom » .. « appartiennent »). Cette relation personnelle comporte un engagement total (Jn 10 :28–30 : « Je leur donne la vie éternelle… périront jamais… nul ne les ravira de ma main…) .
- Cet « engagement » est aussi l’engagement du Christ à l’égard de son Père. Le Père est « celui qui a donné, confié » au Fils ceux qui lui appartiennent. Il y a là une mission particulière du Fils que de nous garder, c’est le mandat reçu de son Père. Cf Jn 10 :29. Avec une parole forte : Jn 6 :39 : « La volonté de mon Père, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés ». Cf aussi Jn 17 :2 (qu’il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, confiés en vue du salut).
- Jésus « donne sa vie » pour nous (Jn 17 :19 : « Je me consacre »… cf « Je veux » 17 :24)
- Jésus prie pour nous : Lc 22 :32 (Pierre) ; Jn 17 :15 ; NB. Rm 8 :34 est plutôt juridique.
- Autre expression de l’engagement : la notion d’adoption. La notion ajoute au lien juridique : elle concerne le « droit » de devenir enfants de Dieu. Lorsque Paul en parle, il ajoute l’héritage. Rm 8 :17 : « Héritiers, cohéritiers ». Cf Ep 1 :3–13 : élus (1 :3) ; enfants d’adoption (1 :5) ; rédemption (1 :7) ; héritiers (1 :11) ; scellés (1 :13).
- Rm 11 :29 : Dieu ne se repend pas de ses dons ni de son appel. Henri Blocher ajoute : « Et moins encore du don de la vie éternelle ! »
- Formidable engagement de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ : « Rien ne pourra nous séparer » ! Rm 8 :38–39.
Cet engagement se dit dans l’humilité et la reconnaissance : cf Canons de Dordrecht, V, III : « A cause de ces restes de péché qui habitent en nous, et des tentations du monde et de Satan, ceux qui sont convertis ne pourraient persister en cette grâce s’ils étaient laissés à leurs propres forces. Mais Dieu est fidèle : il les confirme miséricordieusement dans la grâce qu’il leur a une fois conférée, et les conserve puissamment jusqu’à la fin. »
Q. Comment ces textes sont-ils lus par ceux qui pensent que l’on peut « perdre son salut », et ne pas persévérer ?
La seule manière de les lire est de sous-entendre : « si l’homme demeure dans la foi ».
Difficulté : ce n’est pas ce que disent ces textes ! Ils ne disent pas « Dieu vous préserve si… » Ils disent « Dieu vous préserve de ne pas demeurer dans la foi ». Et il y a des absolus : « Rien », « aucune créature »… au nom de quoi nous exclure nous-mêmes ? un chrétien qui s’éloigne, renie… n’est-ce pas Satan qui l’aura détourné ? Or, il fait partie de ces « dominations, puissances, créatures » dont parle Rm 8.
Il n’y a pas de symétrie entre la façon dont les « calvinistes » intègrent les menaces, et celle dont les « arminiens » évacuent les promesses. Dans le cas des calvinistes : on peut faire une lecture non contradictoire, en faisant des menaces un moyen de la persévérance. Dans le cas des arminiens, on introduit une contradiction : ou bien personne ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, y compris nous-mêmes, ou le diable jouant sur notre faiblesse, ou bien cette parole est fausse. Cf Jn 6 :39 : ou bien la volonté du Père est accomplie, ou bien elle ne l’est pas.
4. Considérations théologiques
Deux autres considérations sont à verser au débat.
1. Le salut est par la foi seule, et non par les œuvres. Ep 2 :8–9. Il est question du « salut ». Et Paul précise : « Ce n’est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie ».
Si l’on fait de la « persévérance » la condition humaine du salut… ne devient-elle pas une « œuvre » ? Puisqu’on dit, précisément, que c’est l’homme, sa liberté qui est en cause ?
Dans le cas où la persévérance est une grâce, un don de Dieu, c’est différent !
2. Nulle part, le Nouveau Testament ne dissocie la régénération et le salut.
Je souligne cela en face de la 2e position : « Dieu régénère, mais tous les régénérés ne seront pas sauvés, ne recevront pas la grâce de la persévérance. Seuls les élus parmi les régénérés recevront le salut éternel, après avoir reçu la persévérance. »
Textes bibliques :
1 Pi 1 :3–6 : régénérés pour une espérance vivante… pour un héritage… à vous qui êtes gardés… pour le salut. Aucune distinction. Si on veut la voir, il faut la mettre ! Mais c’est surimposer qqch au texte.
Tit 3 :5 : Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération.
5. Les cas de chute ou d’abandon de la foi
Les deux séries de textes que nous avons considérés sont bien claires, l’une et l’autre. Il reste que certains textes semblent enseigner la possibilité pour quelqu’un de se détourner définitivement de la foi. Certains personnages bibliques, aussi, ont eu des chutes retentissantes. Et nous connaissons, chacun, des personnes qui apparemment ont commencé dans la foi, et qui ont tout laissé…
Il y a là une vraie difficulté. Qui exige de nous beaucoup d’attention aux textes, ainsi qu’à l’unité de l’Écriture.
51. Les faux-docteurs qui se lèvent dans l’Eglise.
2 Pi 2 :1–2 ; 2 :20–22 : Voilà des gens qui se sont introduits dans l’Église, après avoir eu une « connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 :20). Mais qui se détournent ensuite, s’abandonnent à leurs passions, et cherchent à détourner les autres chrétiens. L’apôtre a des mots très durs contre eux. Si on lit tout le chapitre, on a un réquisitoire parmi les plus forts contre des personnes, dans tout le NT (cf 2 :10b-12).
Q. Qui sont ces personnes, spirituellement ? 2 possibilités :
- Des chrétiens authentiques qui se seront détournés
- Des personnes qui ont eu, un temps, une apparence de piété, ayant entendu le message, mais qui ont ensuite révélé leur propre fonds : tout cela n’était qu’apparence, extériorité. Il n’y avait pas eu de régénération profonde.
La possibilité d’une piété d’apparence
Le NT est très clair sur la possibilité d’une piété d’apparence, d’extériorité, qui fait illusion pendant un temps. Cf 1 Jn 2 :18–19. Il y a là une réalité qu’il nous faut intégrer dans notre vision des choses.
Jésus est allé très loin dans sa mise en garde : Mt 7 :22–23 (contexte = faux prophètes, 7 :15). Verdict de Jésus : « Je ne vous ai jamais connus ». (7 :23). Pas : « vous êtes tombés, vous avez abandonné… » Piété d’apparence. Toutes sortes de paroles, d’actes de puissance même ! Difficile à entendre, mais présent dans NT ! Critère = fruits (7 :16).
Avant ces extrêmes, rappeler la parabole du semeur : il peut y avoir plusieurs types de « réception de la Parole ». Jésus a soin, ici, de ne pas parler simplement en « noir ou blanc » : ceux qui acceptent / ceux qui refusent. Il y a deux catégories intermédiaires : « ceux qui acceptent avec joie, mais sans racine » ; « ceux qui acceptent, mais laissent ensuite être étouffée la Parole ». Ce sont à chaque fois les réponses d’un moment, d’une émotion, d’une sincérité. mais pas réfénération, bonne terre.
52. Les mises en garde contre l’abandon de la foi
L’Epître aux Hébreux va très loin dans ses menaces.
Hb 6 :4–8 (+ 6 :9–10) : voilà des personnes en qui une œuvre de Dieu s’est faite (6 :4 : « éclairés », « goûté le don céleste », « eu part au SE », « goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir ». Et pourtant, menace réelle : si elles tombent, elles ne pourront pas être renouvelées « à nouveau », et amenées à la repentance.
Quelles sont les lectures de ce passage ?
(1) Il s’agit là de gens authentiquement nés de nouveau, et qui peuvent donc tomber définitivement. On souligne la force des mots qui décrivent leur expérience spirituelle. On en déduit qu’il y a là une vraie possibilité pour le chrétien.
(2) On est encore dans l’avertissement. Le plus solennel qu’il soit. Parce que la situation des lecteurs est grave, la tentation d’abandonner très forte. L’auteur multiplie les termes pour que ses destinataires se reconnaissent bien : attention, pas de renouvellement possible si vous niez Jésus comme le Christ, en retournant au Judaïsme. Parole forte, car situation grave. Mais son attente, sa confiance regardent plus loin : 6 :9 -> « Quoi qu’il en soit, nous attendons des choses meilleures en ce qui vous concerne, et favorables au salut ». Il a confiance, il attend de Dieu, que son exhortation serve à les maintenir dans la persévérance. [3]
Le contexte, en tout cas, éclaire une expression : « Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu ». A comprendre dans le contexte de tentation de retour au Judaïsme : ce retour implique la négation que Jésus est l’Envoyé de Dieu, et donc le sens de son sacrifice. Cf toute l’argumentation de l’épître, pour montrer le caractère unique de Jésus : c’est tout cela qui serait nié par un retour en arrière.
(3) Une troisième interprétation trouve la précédente quelque peu artificielle et préfère voir l’ensemble de ce passage comme une explication de la raison pour laquelle l’auteur ne va pas revenir aux « choses élémentaires » (6 :1) : cette prédication-là ne pourrait pas convaincre ceux qui sont déjà tombés. Qui sont déjà retournés au judaïsme. Il y a donc un jugement de fait, à propos de personnes déjà tombées. Question : ces personnes étaient-elles vraiment régénérées ? On relève alors que l’auteur évite soigneusement de parler de « régénération ». Qu’il parle même d’eux comme une terre qui, bien qu’arrosée, produit des épines et des chardons (6 :8). Quelque chose a levé, s’est passé, mais ce n’est pas la bonne terre : la nature n’a pas été régénérée, malgré les privilèges extérieurs (pluie). Cf H.Blocher, R.Nicole.
La différence entre (ii) et (iii) est surtout une question de sensibilité « littéraire » : est-ce que l’auteur est encore dans un processus où il essaie d’avertir, ou est-ce qu’il constate que, pour certains, le mal est fait, sans pour autant dire qu’ils étaient régénérés ? Personnellement, je préfère la solution (ii) : parce que toute l’épître est un avertissement, et l’auteur est pleinement engagé, tout au long, dans son plaidoyer pour que ses destinataires, ébranlés, tiennent bon dans leur foi en Christ.
Ceci dit, il faut rendre compte du langage sur l’oeuvre de Dieu réalisée dans les personnes que l’auteur avertit. Ce langage signifie-t-il qu’ils sont nés de nouveau ?
Il faut, ici, se rendre compte de la difficulté que rencontre l’auteur s’il veut avertir avec force ses destinataires chancelants. Il a toutes les raisons de croire qu’ils sont authentiquement au Seigneur (6 :9). En même temps, si certains retournent au Judaïsme et nient Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils montreront par là qu’en effet, ils étaient une « mauvaise terre », pas vraiment renouvelée par le Seigneur, malgré ce qui s’était passé en eux, et qui avait commencé à lever (6 :8). Que fait-on, quand on est prédicateur, et qu’on est en face de ce genre de situation ? On choisit ses mots, avec soin, on va aussi loin que l’on peut sans aller trop loin. C’est ce qu’on voit ici : les mots qu’il emploie sont susceptibles d’une interprétation « faible » comme d’une interpétation « forte ».
Être « éclairé » : sens fort : avoir reçu la lumière, pour une illumination qui transforme, ou (sens faible) comme « connaissance » qui n’a pas fait tout son chemin de renouvellement…
« avoir goûté le don céleste » : peut signifier (sens fort) : « goûter que le Seigneur est bon » ; ou «(sens faible) avoir eu une toute petite quantité, pour essayer (Cana).
« avoir pris part au SE » : peut signifier (sens fort) une pleine participation, ou (sens faible) une participation à un moindre niveau (première sensibilisation, participation extérieure).
Ce qu’il faut reconnaître, c’est que qqch s’est fait : il est impossible qu’ils soient « encore » renouvelés. Une première action de Dieu dans le coeur est présupposée. Mais à quel niveau ? On peut lire le « plus » ou le « moins ».
Ma lecture : l’auteur va aussi loin qu’il peut parce qu’il veut avertir ses destinataires chrétiens en attendant des choses « favorables au salut » ; mais il garde une réserve dans les termes (pas « régénéré »), au cas où, parmi ses destinataires, certains « tombent » (v.6) et manifestent par là qu’il « n’étaient pas » une bonne terre. Quand on est prédicateur, et qu’on s’adresse à un auditoire varié, on pèse parfois les mots de cette façon.
Une lecture qui, dans le contexte, se comprend bien, sans remettre en question les promesses de persévérance finale pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau.
Même lecture pour le texte d’Hb 10 :26–29. Contexte = négation de Jésus comme Christ et sauveur qu’implique le retour au judaïsme. Avec un point à élucider : « sang de l’alliance par lequel il a été sanctifié ». Qui ? Le croyant ? Probablement, Jésus est ici désigné : cf Jn 17 :19, qui correspond à la christologie de toute l’épître (2 :10 – Christ « rendu parfait » en tant que grand Prêtre, par le don de lui-même).
53. Les exemples personnels de défection
Il y a des exemples de chute, ou de défection. Reniement de Pierre, adultère criminel de David. Gens qui « n’étaient pas des nôtres ».
Nous n’en savons pas beaucoup sur les cas. Attention aux conclusions hâtives. Quelques repères quand même.
1. Chute grave, mais avec retour : cf Pierre – David
2. Abandons grave, qui ne signifient pas forcément « perdre la grâce » : Démas (2 Tm 4 :10, cf 1 :15). Paul se garde d’un jugement, qu’il donne pourtant plus loin : 4 :14–15 (Alexandre le forgeron).
3. « Renier la foi » peut signifier un « comportement contraire à la foi » : 1 Tm 5 :8. H.Blocher : « Celui qui fait cela est plus blâmable qu’un infidèle, mais il ne cesse d’être croyant « Égaré loin de la foi » (1 Tm 6 :10, par l’argent ; 6 :21, par les fables, disputes) : échec pratique ? vie chrétienne manquée ? salut, mais au travers du feu ? Cf « naufrage par rapport à la foi », 1 Tm 1 :19
4. 1 Tm 1 :20 : Hyménée et Alexandre, « livrés à Satan afin qu’ils apprennent à ne plus blasphémer ». Cela signifie-t-il « voués à l’enfer » ? Il faut relever une expression semblable avec une portée moindre, en 1 Co 5 :5 -> jugement temporel.
5. 1 Jn 2 :19 : le cas des antichrists – clairement « ils n’étaient pas des nôtres ».
Il est utile qu’il y ait toute cette palette de cas dans le NT. Cela donne une latitude de possibilités pour les cas difficiles. C’est vrai, il ne faut pas nier qu’il y a des cas troublants. Mais il me semble que les catégories du NT sont assez large pour en intégrer plusieurs, sans pour autant parler de « perte du salut ».
Octobre2013
HPC10062013